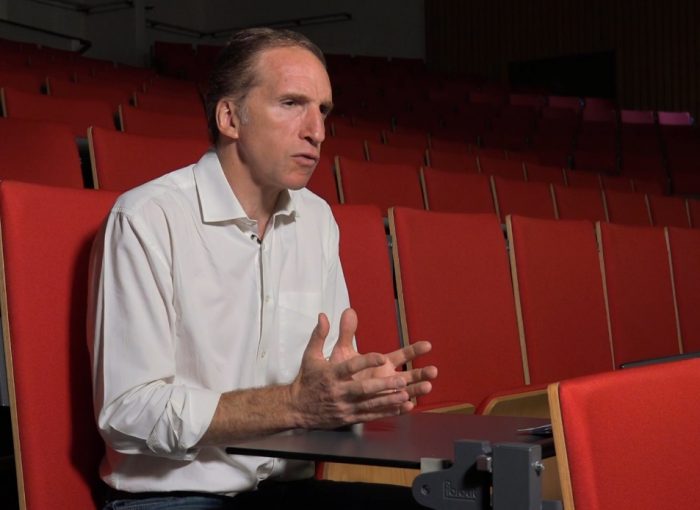Le professeur Matthieu de Nanteuil (UCLouvain) nous présente l’« anti-violence » comme seule capable de traiter, de civiliser les formes de l’extrême violence de notre société moderne, qu’il s’agisse des violences de l’état de droit, de la violence au travail, des violences de genre, des violences contre la Terre et le climat….
L’intervention du professeur Matthieu de Nanteuil ouvre une réflexion profonde et contemporaine sur la manière de répondre à l’extrême violence qui a marqué et continue de marquer nos sociétés. En lien avec les insurrections tragiques du maquis du Vercors et de Varsovie en 1944, cette idée permet d’interroger non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi leur héritage symbolique et leur pertinence pour penser la violence dans le monde moderne.
L’extrême violence des insurrections de 1944
Les événements du Vercors et de Varsovie incarnent des formes d’extrême violence, tant dans leur essence que dans leurs conséquences. Ces résistances ont été des réponses à une violence systématique imposée par les régimes totalitaires. Elles ont exprimé une volonté collective de rejeter l’oppression, mais leur écrasement brutal a révélé l’impitoyable logique des guerres modernes : des populations civiles massacrées, des régions détruites et un déséquilibre criant entre oppresseurs et opprimés.
Ces épisodes historiques nous rappellent que la violence, même lorsqu’elle est légitimée par la lutte pour la liberté, peut engendrer des souffrances profondes et durables, à la fois matérielles et psychologiques. Dans ce contexte, la notion d’« anti-violence » prend tout son sens.
L’« anti-violence » face à l’histoire et à la mémoire
Pour Matthieu de Nanteuil, l’« anti-violence » ne signifie pas une simple absence de conflit ou une naïve utopie de paix totale. Il s’agit plutôt d’un processus visant à civiliser les formes de violence, à les canaliser et à en réduire les effets destructeurs. Appliquée aux insurrections de 1944, cette idée nous invite à réfléchir sur les moyens qui auraient pu prévenir ou atténuer la brutalité des événements.
Dans le cas du Vercors, par exemple, aurait-il été possible de mieux anticiper les représailles allemandes grâce à une coordination plus efficace avec les Alliés ? À Varsovie, l’attentisme de l’Armée rouge, qui a observé la destruction de la ville sans intervenir, aurait-il pu être remplacé par une action plus décisive, évitant un tel massacre ? Ces questions n’ont pas de réponse simple, mais elles nous poussent à envisager des alternatives à la confrontation brutale.
L’anti-violence dans les sociétés modernes
En extrapolant le concept au-delà des événements historiques, l’« anti-violence » propose une réponse aux nombreuses formes de violence qui subsistent aujourd’hui, qu’il s’agisse de violence structurelle (dans le travail, l’économie, ou les relations sociales) ou de violence envers la Terre et les générations futures. En écoutant Matthieu de Nanteuil, nous pouvons nous sentir invités à développer des institutions, des pratiques et des cadres éthiques capables de reconnaître et d’encadrer ces violences, pour en atténuer les effets destructeurs et promouvoir des solutions durables.
Les résistants du Vercors et de Varsovie, bien qu’engagés dans une lutte armée, aspiraient à des idéaux de justice, de dignité et de liberté. Ces aspirations résonnent aujourd’hui dans les luttes contemporaines contre les injustices sociales, les inégalités et les violences systémiques. L’« anti-violence » pourrait être vue comme une prolongation des valeurs portées par ces résistances : une manière d’honorer leur mémoire en cherchant des formes de lutte et de transformation sociale qui privilégient la construction plutôt que la destruction.
Une leçon pour l’avenir
En reliant les insurrections sanglantes de 1944 à la notion d’« anti-violence », ce film documentaire pourrait non seulement rappeler les horreurs du passé, mais aussi éclairer le présent et inspirer l’avenir. La mémoire des résistants du Vercors et de Varsovie nous appelle à dépasser les logiques de guerre et de répression, pour imaginer des voies alternatives où le courage et la résilience ne s’expriment plus uniquement dans la confrontation, mais aussi dans la création de mondes plus justes et moins violents.
Article : André Bossuroy